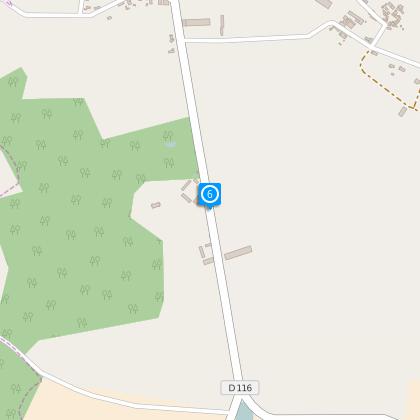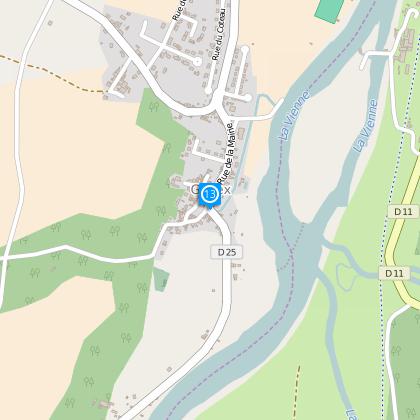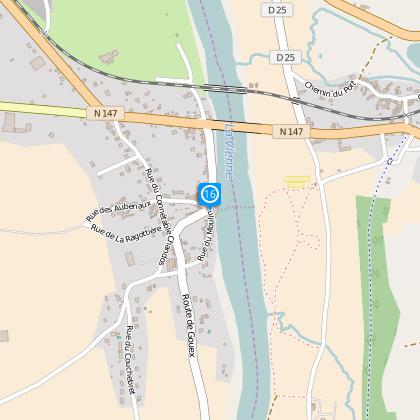Alerte
Alertes
Type de pratique
Vélo route
Très facile
VTC
Très facile
Camping-car
Très facile
Voiture
Très facile
Moto
Très facile
Présentation
Description
Carte
Étapes
Notes et avis
À voir autour
Le Lussacois, du plateau aux trois vallées.

Crédit : OT LUSSAC
Cartes IGN
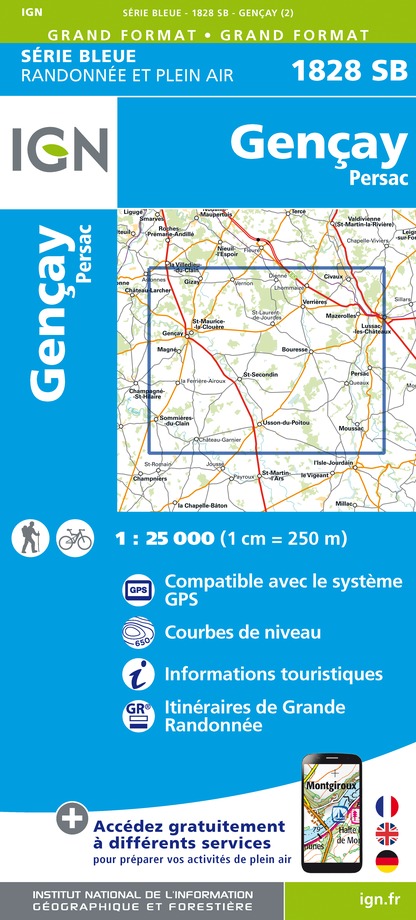
1828SB - GENÇAY PERSAC
Editeur : IGN
Collection : TOP 25 ET SÉRIE BLEUE
Échelle : 1:25 000
13.90€

1928SB - MONTMORILLON LATHUS-SAINT-RÉMY
Editeur : IGN
Collection : TOP 25 ET SÉRIE BLEUE
Échelle : 1:25 000
13.90€

139 POITIERS CHÂTELLERAULT PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA BRENNE
Editeur : IGN
Collection : TOP 100
Échelle : 1:100 000
8.40€

D79-86 DEUX-SÈVRES VIENNE
Editeur : IGN
Collection : CARTES DÉPARTEMENTALES IGN
Échelle : 1:150 000
5.90€

D23-87 CREUSE HAUTE-VIENNE
Editeur : IGN
Collection : CARTES DÉPARTEMENTALES IGN
Échelle : 1:150 000
5.90€

D16-17 CHARENTE CHARENTE-MARITIME
Editeur : IGN
Collection : CARTES DÉPARTEMENTALES IGN
Échelle : 1:150 000
5.90€

NR07 PAYS DE LA LOIRE
Editeur : IGN
Collection : CARTES RÉGIONALES IGN
Échelle : 1:250 000
6.80€

NR08 CENTRE-VAL DE LOIRE
Editeur : IGN
Collection : CARTES RÉGIONALES IGN
Échelle : 1:250 000
6.80€
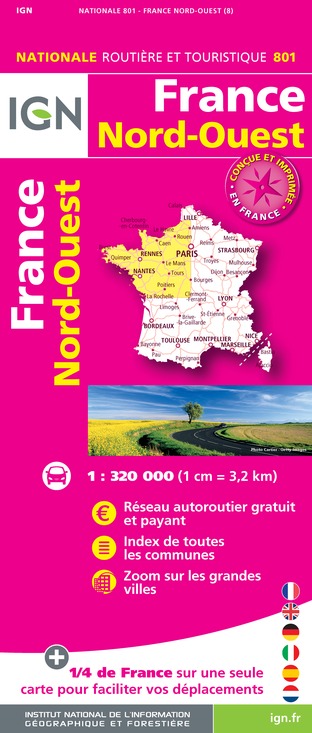
801 FRANCE NORD OUEST
Editeur : IGN
Collection : CARTES NATIONALES IGN
Échelle : 1:320 000
6.10€
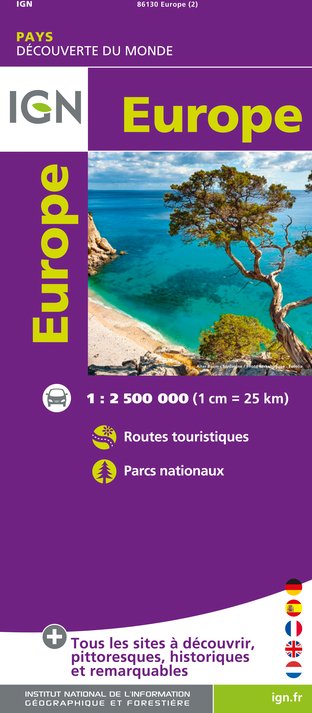
EUROPE
Editeur : IGN
Collection : DÉCOUVERTE DES PAYS DU MONDE IGN
Échelle : 1:2 500 000
7.00€
Description
Ce circuit vous emménera entre nature et patrimoine découvrir ce territoire au sud est de la Vienne. Ce circuit vous est proposé par l'office de tourisme de Lussac les Châteaux : www.tourisme-lussac-les-chateaux.fr
Département de la Vienne -Poitou Charentes -centre ouest de la France
Informations techniques
Vélo route
Difficulté
Très facile
Dist.
36 km
Type de pratique
Vélo route
Très facile
VTC
Très facile
Camping-car
Très facile
Voiture
Très facile
Moto
Très facile
Afficher plus d'informations
Profil altimétrique
Point de départ
86320
Lussac-les-Châteaux
Lat : 46.40242Lng : 0.7247
Étapes
Auteur de la donnée

proposé par
Office de tourisme Sud Vienne Poitou
2 place du maréchal Leclerc 86500 MONTMORILLON France
Notes et avis
À voir autour