Alerte
Alertes
L’église Saints-Pierre-et-Paul

Description
L’église Saints-Pierre-et-Paul se dresse sur la place de l’abbaye en contrehaut de la vallée de la Lys et à proximité des sites de l’ancienne abbaye et du complexe castral disparus. L’édifice actuel remplace une église construite en 1665 et qui conservait une tour romane, totalement détruite lors des bombardements allemands de 1915. En 1919, les premiers habitants de Warneton se réinstallent dans une région dévastée par d’intenses pilonnages d’artillerie qui ont entièrement rasé la localité. Rapidement, les autorités communales se mobilisent pour rebâtir Warneton et décident de confier un ambitieux projet de construction et d’aménagement d’une ville de style Art nouveau à l’architecte anversois Jean-Robert Vanhoenacker assisté de Joseph Smolderen et John Van Beurden. Cette option innovante s’écarte des villes et villages voisins qui réédifient leurs bâtiments à l’identique comme avant la guerre.
La première pierre est posée le 21 septembre 1924 et sa construction dure quatre années. L’édifice surprend par son style et ses dimensions hors normes pour une commune de la taille de Warneton. En effet, le nouvel édifice est deux fois plus vaste que l’ancienne église et sa tour domine désormais toute la vallée de la Lys. L’église Saints-Pierre-et-Paul est construite dans un style moderne qui se caractérise par l’influence de nombreux courants architecturaux. Il s’agit d’une architecture reflétant diverses influences faisant de celle-ci un exemple rare de mélange néoroman, néobyzantin et d’Art déco. Élevé sur le plan basilical, le sanctuaire est bâti en béton, briques jaunes et calcaire, et est coiffé de toitures d’ardoises naturelles. Résolument inscrite dans le style Art déco par les modénatures mises en œuvre et par le décor intérieur, l’église est conçue comme une œuvre d’art globale. Elle se compose d’une nef de trois travées, introduite par un portail de façade et éclairée par trois verrières hautes, flanquée d’une tour latérale, greffée de bas-côtés et suivie du transept et du chœur cernés par des chapelles et par la sacristie. L’intérêt de l’édifice réside également dans l’utilisation d’un matériau novateur pour l’époque : le béton. Celui-ci est notamment utilisé pour réaliser les voûtes et les coupoles de l’église qui constitue une prouesse technologique en ces temps de reconstruction.
Le mobilier liturgique de l’église de Warneton constitue une des curiosités des lieux. En effet, la chaire de vérité, les autels, les lutrins, les confessionnaux, les bancs de communion sont réalisés en céramique flammée et témoignent d’une maîtrise totale du procédé dit de réaction par les célèbres ateliers Helman à Bruxelles. Cette technique, consistant à cuire à haute température des éléments de grès fin puis de les enduire d’une couche d’émail donnant des couleurs particulières et uniques, n’était maîtrisée que par trois ateliers bruxellois à savoir la maison Helman, l’atelier de Janssens (Berchem-Sainte-Agathe) et la fabrique Vermeren-Coché (Ixelles). Incontestablement, les ateliers Helman jouissaient d’une réputation supérieure à leurs concurrents et ont dominé le marché belge et international jusque dans les années 1950.
Classement comme monument (église et tous les biens immobiliers par destination) et établissement d’une zone de protection le 12 mai 2021
Informations techniques
Profil altimétrique
Cartes IGN
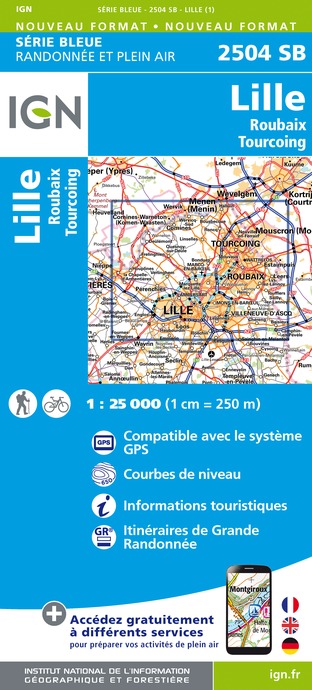
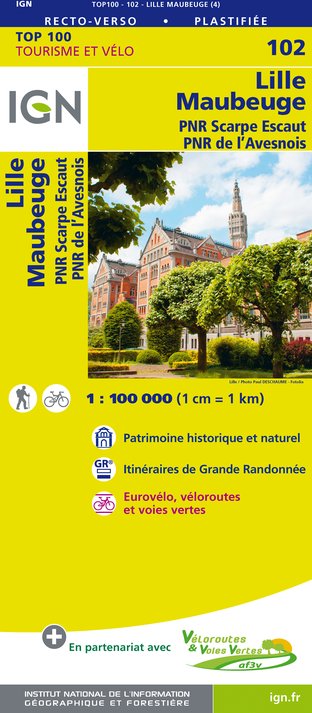



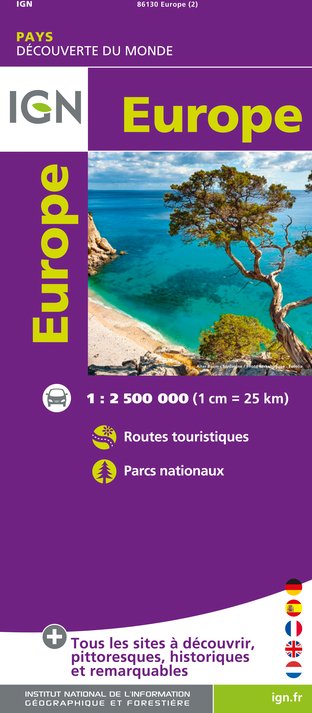

Auteur de la donnée
